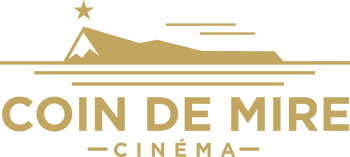LES FILMS DU JEUDI
Aujourd’hui, nous avons pu échanger avec Laurence Braunberger, gérante de la Société Les Films du Jeudi, que nous avons rencontrée au début de notre aventure d’éditeur, lorsque nous cherchions des films de patrimoine à faire (re)découvrir à l’instar de Martin Roumagnac, Elle court elle court la banlieue, ou encore Erotissimo que nous attendons d’éditer avec impatience…
Vous avez repris la société de Pierre Braunberger, votre père, l’un des principaux producteurs indépendants du cinéma français du siècle dernier. Il a donné sa chance et produit les premiers films de futurs grands réalisateurs, mais comment cela s’est-il passé ? Pour lui ? Et pour vous ?
Les Films du Jeudi est la société principale et la plus connue du groupe de sociétés fondées successivement par mon père Pierre Braunberger (1905-1990).
Il a commencé sa carrière à l’aube du cinéma et a passé sa vie à produire, à distribuer et à montrer des films. Il avait un flair incroyable et a découvert plusieurs générations de réalisateurs dont il a produit les premiers films, notamment Jean Renoir à la fin des années 1920 et la plupart des réalisateurs de la Nouvelle Vague : Truffaut, Godard, Resnais, Rivette, Marker mais aussi Lelouch pour n’en citer que quelques-uns.
Quand il avait des soucis de trésorerie, il vendait le négatif d’un de ses films (souvent à son réalisateur), mais il a aussi racheté des catalogues d’autres sociétés de production comme celui de la Sud Pacifique Films dans lequel il y avait, entre autres, Martin Roumagnac.
Par ailleurs, dès 1929, il a acquis le Cinéma du Panthéon ce qui lui a permis de diffuser et de promouvoir les films qu’il produisait ou distribuait. Il a été le premier dans les années 1930 à montrer les films en version originale.
J’ai repris la gestion des sociétés en 1991 après son décès et je me suis donc formée sur le tas à tous les niveaux : juridique, commercial, comptable. J’ai très vite recruté mes collaboratrices qui sont encore là aujourd’hui.
Vous gérez un catalogue de films qui évidemment nous intéresse dans le cadre de notre projet éditorial. Lors de nos rencontres pour en discuter nous avons pu voir à quel point ce métier était chronophage et que vous y consacriez énormément de temps. Votre lieu de travail fait ainsi l’effet d’un bureau-maison, l’ambiance est chaleureuse, et les dossiers d’archives côtoient les souvenirs d’une vie consacrée au cinéma, avec entre autres de très belles affiches anciennes et une collection de lanternes magiques. Quel est votre quotidien au travail ?
J’ai la chance immense de travailler dans un endroit que j’aime (le quartier latin à Paris) et avec des gens que j’ai choisi et que j’apprécie beaucoup. C’est un énorme luxe! C’est un travail, où il ne faut pas compter son temps, d’autant que nous ne sommes plus aussi nombreux que nous avons pu l’être.
Au quotidien, je passe des heures devant mon ordinateur à répondre aux mails, travailler sur des contrats, faire des relances en tout genre, effectuer des recherches; mais aussi à rencontrer les gens avec qui nous travaillons ou souhaiterions travailler.
Je passe aussi pas mal de temps dans les laboratoires pour suivre presque toutes les étapes des restaurations.
Avec plus de 400 films et une mini structure, le travail est infini. Il y a toujours des films à découvrir, du matériel à retrouver, d’autres films à mettre en avant. Et en même temps, il est cyclique : on renouvelle les droits d’auteurs pour la deuxième ou troisième fois, et on rerestaure les films aussi. Les supports et les normes évoluent, tout est toujours à refaire!
Nous faisons aussi un peu de production : j’aime à dire que je produis avec autant de parcimonie que mon père le faisait avec boulimie. Nous avons produit des courts-métrages (dont Hommage à Alfred Lepetit de Jean Rousselot qui a gagné l’ours d’or à Berlin), mais aussi les dernières œuvres de Chris Marker (Chats Perchés, Gorgomancy) et plus récemment le film documentaire de Stéphane Ragot Patria obscura.
Ces films viennent enrichir le catalogue tout en gardant une cohérence avec le travail de mon père : le premier est un faux documentaire sur l’amour du cinéma, mon père avait déjà produit Marker et le film de Stéphane Ragot est aussi un travail et une réflexion sur les archives.
Vous mentionnez votre suivi assidu des différentes étapes de la restauration en laboratoire. Aujourd’hui pour que l’on puisse proposer un contenu de qualité, l’édition de films de patrimoine passe nécessairement par un travail de restauration sur l’image et le son. Comment abordez-vous chaque nouvelle restauration ?
Depuis quelques années, et grâce au soutien du CNC, nous nous sommes concentrés sur la restauration des films du catalogue: quatre à six films par an, c’est beaucoup pour nous.
Les moments les plus forts (en dehors de ceux liés à la production) ont été tout d’abord la restauration de Lola Montès (1955) de Max Ophuls en 2008, car il s’agissait de notre première grande restauration. Nous l’avons faite avec la Cinémathèque française en collaboration avec Marcel Ophuls, la Fondation Thomson pour le patrimoine du cinéma et de la télévision, avec le soutien du Fonds Culturel Franco-Américain, grâce au mécénat de L'Oréal et Agnès B, avec le concours du Filmmuseum Münchnen, de la Cinémathèque Royale de Belgique, de la Cinémathèque de la ville de Luxembourg, et les conseils techniques de François Ede. Rien que ça!
Il s’agissait de restituer la version originale du film qui n'avait pas été revue depuis sa sortie. En effet, devant l'échec commercial du film, le producteur l’avait remonté dans un ordre chronologique. Mon père l’avait racheté suite à la liquidation de la maison de production, mais il n’avait pu le restaurer qu’avec les moyens de l’époque, c’est-à-dire en argentique. Le numérique nous a offert beaucoup plus de possibilités, tant au niveau des couleurs, que de la restitution de la stéréo sur quelques scènes et du cadre. Le film était attendu à Cannes, et nous avons fait avec les partenaires un peu le tour du monde avec.
La restauration et la création musicale du Voyage au Congo (1926) que Marc Allégret a fait avec André Gide a été un autre moment fort. La restauration effectuée entre 2015 et 2017 a pris beaucoup de temps car le négatif original était très abîmé et il a fallu négocier longtemps avec les archives anglaises (La BFI) pour avoir accès aux éléments qu’ils conservaient. La musique a été composée par Mauro Coceano et jouée par 17 musiciens. Nous y avons pensé pendant longtemps et nous avons beaucoup discuté sur ce qui devait être fait. C’est un travail musical autour du silence avec différentes sources d’inspiration, notamment africaines. Cela a été un travail passionnant et je suis très heureuse du résultat. Il y a eu un très beau ciné concert à l’auditorium du Louvre en 2018.
Cela fait maintenant plus de trente ans que vous avez repris la succession de votre père. Vous avez effectué un long parcours dans ce milieu. Pourriez-vous partager un peu vos expériences avec nous et ceux qui nous liront… Quel est votre meilleur souvenir, vos plus belles rencontres, votre plus grand échec ?
Mon meilleur souvenir c’est en 2000 à Berlin quand nous avons reçu l’ours d’or pour le film Hommage à Alfred Lepetit de Jean Rousselot. Le pire, c’était les papiers bleus des huissiers à la mort de mon père.
Mes plus belles rencontres c’est tout d’abord Chris Marker que j’ai rencontré à la fin des années 80 chez Anatole Dauman, et dont j’ai été l’assistante puis la productrice. C’était quelqu’un d’exigeant, d’incroyablement créatif dans tous les domaines, cultivé et qui poussait chacun à donner le meilleur de soi-même. Sa disparition a été un immense vide pour tous ceux qui l’ont connu. La deuxième, c’est Michel Schmidt qui travaillait à l’époque chez Gaumont et qui par sa confiance et son soutien m’a poussé à reprendre les rênes des sociétés à une époque où j’hésitais sur ce que j’allais faire professionnellement.
Le plus grand échec, c’est de ne pas avoir réussi à produire Chez Vincent un long-métrage « d’amour et de cuisine » coécrit avec Jean Rousselot. C’est un projet qui ne me ressemble plus vraiment, mais auquel j’ai beaucoup cru et pour lequel je me suis beaucoup battue.
Lors de nos discussions concernant une potentielle édition d’Erotissimo, vous nous aviez précisé « On préfère trouver des éditeurs qui veulent éditer nos films parce qu’avant tout chose, ils les aiment ». Quels sont vos plus grands espoirs aujourd’hui ?
Mes plus grands espoirs c’est d’arriver à continuer mon métier et à le défendre de manière plus responsable tant au niveau de la restauration, de la conservation et de la production. J’aime l’idée que nous continuons à faire vivre ceux qui ont disparus, mais cela ne doit être en aucune façon au détriment de la planète. Je crois que le défi de notre siècle est d’arriver à se soucier plus de l’humain et du monde qui l’entoure. D’être plus créatif à tous les niveaux.